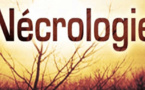C'est presque du jamais-vu dans l'histoire de la médecine en France. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a mis jeudi sur les rails sa plateforme Covireivac qui doit permettre de recruter 25 000 volontaires pour tester les vaccins contre le Covid-19, détaille Le Monde. Cet appel, accompagné du hashtag #jetestelevaccincovid, s'adresse aux hommes et aux femmes majeurs qui sont invités à « participer à un défi historique au côté de la communauté médicale et scientifique ».
« De nombreux essais cliniques ont déjà été réalisés en France pour d'autres vaccins comme la grippe saisonnière ou le VRS, mais jamais nous n'avions développé une plateforme de ce type. Il faut dire que nous n'avions jamais connu de situation sanitaire justifiant de réaliser des essais cliniques avec un aussi grand nombre de sujets, sur une période aussi courte », souligne l'infectiologue Odile Launay, chargé de la coordination du projet, au Monde. La plateforme Covireivac se reposera sur 24 centres d'investigation clinique (CIC) qui font partie intégrante de plusieurs CHU en France.
Les vaccins sélectionnés pas encore connus
Pour l'heure, les personnes souhaitant participer aux essais doivent renseigner différentes informations sur le site, notamment leur état de santé et leur lieu de résidence. Les chercheurs de l'Inserm sélectionneront les candidats en fonction de leurs critères pour les futurs essais qui doivent débuter à la fin 2020 et qui dureront deux ans. Les vaccins qui seront testés n'ont, pour l'instant, pas été sélectionnés. « Les fabricants auprès de qui l'Union européenne a passé des précommandes » sont visés et des discussions se déroulent actuellement. Un essai de phase 2, codirigé par l'AP-HP et l'Inserm, va être lancé avec des volontaires âgés.
« Avant de vacciner les personnes les plus âgées, nous voulons pouvoir étudier la réponse immunitaire obtenue avec ces vaccins sur cette population, qui est la plus à risque de formes graves et de décès », détaille Odile Launay. Deux cents candidats sont recherchés pour ce premier essai. Le reste de l'immense contingent recherché par l'Inserm participera à des essais de phase 3 « à promotion industrielle ». Pendant une durée d'un an, les candidats seront suivis de près. Ils seront indemnisés d'une somme allant d'une dizaine d'euros à environ 300 euros, la rémunération étant interdite en France. Si des effets indésirables surviennent, les patients seront pris en charge.
« De nombreux essais cliniques ont déjà été réalisés en France pour d'autres vaccins comme la grippe saisonnière ou le VRS, mais jamais nous n'avions développé une plateforme de ce type. Il faut dire que nous n'avions jamais connu de situation sanitaire justifiant de réaliser des essais cliniques avec un aussi grand nombre de sujets, sur une période aussi courte », souligne l'infectiologue Odile Launay, chargé de la coordination du projet, au Monde. La plateforme Covireivac se reposera sur 24 centres d'investigation clinique (CIC) qui font partie intégrante de plusieurs CHU en France.
Les vaccins sélectionnés pas encore connus
Pour l'heure, les personnes souhaitant participer aux essais doivent renseigner différentes informations sur le site, notamment leur état de santé et leur lieu de résidence. Les chercheurs de l'Inserm sélectionneront les candidats en fonction de leurs critères pour les futurs essais qui doivent débuter à la fin 2020 et qui dureront deux ans. Les vaccins qui seront testés n'ont, pour l'instant, pas été sélectionnés. « Les fabricants auprès de qui l'Union européenne a passé des précommandes » sont visés et des discussions se déroulent actuellement. Un essai de phase 2, codirigé par l'AP-HP et l'Inserm, va être lancé avec des volontaires âgés.
« Avant de vacciner les personnes les plus âgées, nous voulons pouvoir étudier la réponse immunitaire obtenue avec ces vaccins sur cette population, qui est la plus à risque de formes graves et de décès », détaille Odile Launay. Deux cents candidats sont recherchés pour ce premier essai. Le reste de l'immense contingent recherché par l'Inserm participera à des essais de phase 3 « à promotion industrielle ». Pendant une durée d'un an, les candidats seront suivis de près. Ils seront indemnisés d'une somme allant d'une dizaine d'euros à environ 300 euros, la rémunération étant interdite en France. Si des effets indésirables surviennent, les patients seront pris en charge.


 Covid-19 : l'Inserm recherche 25 000 volontaires pour tester les vaccins
Covid-19 : l'Inserm recherche 25 000 volontaires pour tester les vaccins